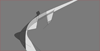VERS UN THEATRE D'ART
LETTRES MODERNES MINARD -
CAHIER PAUL VALERY 10
(Parution novembre 2003)
CAHIER PAUL VALERY 10
(Parution novembre 2003)

Louis LATOURRE

A la mémoire de
Sylvie Engammare-Delvallée
Sylvie Engammare-Delvallée
Avant toute parole l’aspiration, la captation de l’air. Avant tout son de lyre, le frôlement d’une main, le frottement d’une phalange qui cherche sa corde…
Ces dix pages résument 25 ans de travail. Le bruit de la langue s’efforce d’y participer au sens ; l’articulation sonore, d’étayer la pensée.
Ces dix pages résument 25 ans de travail. Le bruit de la langue s’efforce d’y participer au sens ; l’articulation sonore, d’étayer la pensée.
Une fontaine, une clairière… Le décor « naturel » de Narcisse sera celui voulu par chaque spectateur, sur une scène vierge et travaillée d’éclairages simples. Mais ce dépouillement voudra d’autant plus d’art : celui de suggérer l’eau « froidement présente », le plus librement possible, dans le dénuement de l’espace scénique ; celui de transcender la nudité de l’argument en recomposant tous gestes et déplacements de l’acteur dans le tissu transparent du poème.
Par chacun de ses pas, chacun de ses regards, Narcisse doit chercher tantôt la résonance et tantôt la naissance des sentiments surpris dans l’eau pure du texte : tout son désir de soi, sa soif de connaissance, cette essentielle incompréhension de vivre qui se nourrit de chacun de nous une fois dépouillés de nos vêtements de paroles. Les vers de Valéry nous suggèrent leur sens. L’acteur doit à son tour nous suggérer leur chant et nous renvoyer donc, aussi bien par ses gestes, aux sources du langage.
Or le silence cède à de nouveaux accents. La nappe d’eau prend corps et devient Nymphe, Femme, et tout ce que l’amour peut offrir de concret. Et Narcisse un instant croit saisir son image… Mais cet amour offert n’est pas celui voulu. Un désir sans réponse, un malheur réciproque sont seuls à rapprocher Narcisse et l’Amoureuse. Nul ne saurait s’unir, et plus intimement qu’au plus proche des dieux qu’est chacun pour soi-même.
Ce nous-même à nous-même, insaisissable enfin, est le dernier reflet sur quoi le rideau tombe, d’un Narcisse réduit à l’écho de son chant (1).
§§§
On me pardonnera, je l’espère, d’engager mon lecteur à me suivre sur des chemins qu’il n’appartient qu’à la poésie de tracer. La diction de l’acteur, l’orchestique (art du geste) s’y soumettent au poieîn autant que l’écriture. La mise en scène entière n’est pas moins travaillée. Tentative d’approche, effort vers l’essence de l’expression humaine, la recherche d’un théâtre d’art véritable se situe au cœur même - je n’ose dire en amont - de toute la recherche dont l’expression demande la parole, et le corps.
§§§
Qu’est-ce donc que parler, s'interroge un poète... Quel est cet acte étrange ? Et d’où vient tant de foi dans cette expiration, dans cette restitution d’un peu de l’air qui nous entoure changé en verbe par l’appareil de la phonation, et revêtu de sens par l’habitude ? Tandis que nos yeux cherchent, tantôt en nous-mêmes, tantôt dans tel autre, à peser ce presque immatériel effet de paroles dans l’inquiétude de quelque affermissement secret…
Nous ne savons au mieux que notre incertitude. Jusqu’en leurs inflexions, jusque dans leur phrasé, nos langues n’ont de sens que par des conventions que la force d’habitude nous rend insensibles. Travaillés de leur bruit dès avant la naissance, soumis à leurs figures dès nos balbutiements, dressés à leur usage le plus commun par toute notre éducation, nous ne pouvons guère adultes nous défaire ni des notions, ni des questions, ni des schémas de raisonnement contenus par avance dans leurs mots imposés. Vocabulaire, syntaxe, conjugaisons, modes et temps nous offrent suffisamment de combinaisons possibles pour donner le change : nous confions notre pensée à ces mots, à ces phrases, dont nous identifions (et substituons) la production intellectuelle à la perception des vérités et des réalités qu’ils sont censés couvrir. Nous ne pensons jamais - et pour cause - quelles pensées notre langage nous empêche de former.
C’est précisément là, pesant notre ignorance, mesurant les limites de nos capacités d’expression (et celles de cette conscience dont nous doutons si peu d’être doués), que nous concevons mieux comment peuvent naître et grandir une poésie et un théâtre soucieux de s’affirmer contre le sentiment d’impuissance essentielle qui les engendre - une poésie d’abord, inquiète de se dresser suffisamment armée contre toutes les réponses réflexes dont la parole nous tient captifs. Il faut prendre au langage de quoi le renverser. Il faut créer le vers.
Il peut sembler étrange (et l’on s’étonne parfois) de voir un poète vivant demander à la forme versifiée les chemins d’une expression nouvelle. On invoque le grand poids des contraintes du nombre ou de la rime, de la rigueur formelle, de tout l’appareil désuet de l’ancienne poésie que le XXe siècle a voulu dépoussiérer. Mais si l’on fonde son observation sur une histoire littéraire plus large, on s’aperçoit que le premier soin des poètes de tout temps a été d’affranchir leur art des règles en vigueur - non pas en les fuyant, sans doute - mais en les dominant, en les recréant ; en les fécondant chacun pour son usage. Un vers de La Fontaine appartient à lui seul.
Le vers, pour un poète, n’est pas une forme préétablie dans laquelle la pensée n’aurait qu’à se couler sans effort. Le vers est ce qui affecte le plus profondément la langue. Laissant à l’extérieur des mots le rôle ordinaire d’intermédiaire, de truchement de la pensée, le vers demande de leur chair la matière d’une action, d’un effet d’ordre physique et sensible qui amplifie la résonance intellectuelle, et dont s’élargisse le spectre de la signification. Le nombre, la rime et le reste ne paraissent plus que les conséquences du travail profond qu’ils ont appelé : la composition d’accents, de timbres, de couleurs phoniques dont la recherche syntaxique et la rigueur formelle saisissent et fixent les rapprochements les plus expressifs. La leçon (je l’avoue) ne m’en paraît pas si indifférente qu’il faille la laisser perdre. Telle la musique, telle la peinture, la poésie compose des éléments étrangers à toute idée de traduction dans une langue particulière. Le vers est cette chambre de résonance où la pensée et l’expression cherchent l’accord extrême, le point idéal où entendre et comprendre ne seraient plus qu’un mot de même sens.
La moisson des exemples se confond avec la poésie même. De ses diphtongues ici, Racine fait une langue plus charnellement pesante :
Des nasales, Corneille tente une approche au plus près du souffle détimbré (telle une expiration) :
Des mêmes nasales dominées de graves, Valéry descend vers la nuit :
Relisons ces fragments à voix haute. Essayons d’en peser physiquement les attaques et les tenues (par le jeu des consonnes et des voyelles), la richesse des rimes intérieures (Va, dis-je /Vois si je ), les effets de miroir (teinture du tien ), la distribution des sonorités par resserrements, renversements et monnayage, etc. L’appréhension poétique véritable ne souffre ni l’impatience du regard ni cette étrange lecture muette au rythme indépendant de toute respiration. Elle demande au contraire le temps, la durée, et la perception résonnante de ce qui n’est plus seulement écrit mais composé. Dans le cadre d’un théâtre d’art, elle demande ce lecteur et cet acteur singulier pour qui, plus encore que la pensée, la pesée du langage jusque dans ses phonèmes est source d’émotion.
Pour nombre d’entre nous ce réel basculement de la perception n’est pas toujours facile - ni même toujours possible. Sans doute l’habitude de la prose, l’abondance quantitative de la littérature qu’elle produit et le type de lecture qu’elle engendre n’en favorisent-ils guère l’opération. (Ajoutons qu’aussi vagues que répandues, les notions de « musique des mots » ou de « musique de l’idée » attachées à l’écriture du roman et du poème en prose ne peuvent qu’entretenir la confusion.) Mais la physiologie mentale apporte d’autres lumières sur la nature profonde de la compréhension - ou de l’incompréhension - poétique. En attribuant à des régions cérébrales distinctes, d’un côté l’intellection linéaire et la résorption signifiante du langage, et de l’autre son appréhension comme spatiale (incluant le rythme et la résonance), cette science fait dépendre de la perméabilité ou de l’étanchéité des frontières entre ces zones l’orientation du sens esthétique individuel… Aux « étanches » semblerait tout accès poétique interdit.
Une image concrète - empruntée à l’optique - donne de mon propos l’illustration la plus nette. La perception poétique reflète celle de ces créations de l’imagerie informatique appelées stéréogrammes, dont les motifs de surface cachent une figure virtuelle d’un puissant relief. Seuls ceux qui savent voir plus loin que l’apparence perçoivent cette figure surprenante, parce qu’elle surgit d’un point de convergence oculaire étranger à l’habitude du regard (point focal repoussé, reculé dans l’espace au-delà du dessin) - un point focal qui superpose et fond les motifs différemment perçus des deux yeux droit et gauche. Ainsi, face au poème, la saisie du vers dans tout son relief exige la participation sensible des deux hémisphères cérébraux ; et traversant la page, transcendant l’évidence, le point de convergence intellectuelle d’un langage élargi à tout l’être… Même à voix murmurée, même du bout des lèvres, il faut donner au vers tout ce qu’il veut de souffle pour prendre chair en nous.
De Malherbe, Corneille, Racine et quelques autres, la leçon nous révèle autant les chemins faits qu’elle peut en suggérer d’autres - qu’ils n’ont su faire. Ralentie, renforcée par une écoute profonde, la lecture poétique devient chorégraphie du mouvement des lèvres, de la langue, des vibrations du larynx - la seule mélodie de timbres (mélodie intérieure, modulations des couleurs phoniques en fonction des voyelles dominantes) jouant de la mémoire du degré d’ouverture de la bouche. Les tensions vers les voyelles extrêmes (i, u aiguës et o, on graves), les retours vers les moyennes (ain, ein), la durée des tenues et leur périodicité semblent vecteurs d’un sens dont l’étude appartient aux rapports de la psychologie et de l’acoustique… Les ondes du langage ont sans doute leurs ultra-violets et leurs infrarouges, dont les bornes sont précisément celles que l’effort poétique tente d’approcher voire de franchir : peut-être le plaisir sensoriel de la diction (que le vers semble toujours conçu pour susciter) s’explique-t-il par la sensation d’épouser pleinement certaines régions de leur spectre phonique, et par l’excitation d’en risquer des explorations nouvelles de la profondeur ou des limites sensibles.
§§§
Prose ou vers il est vrai - nous ne pouvons parler que nous ne soutenions le son de nos paroles de timbres, de hauteurs, d’intensités, de rythmes, dans une dépendance plus ou moins heureuse des sentiments qui gouvernent le choix de nos mots et l’effet que nous cherchons à produire en parlant. Mais s’agissant du vers - du vers irréductible, composition des plus expressives ou des plus rares dont soit capable le langage écrit - nous devons espérer du travail de l’acteur une composition d’équivalente qualité dans son rendu sonore, une séquence d’inflexions choisies qui transpose à l’oreille, dans l’espace de la scène, cette recherche d’un dire absolu et comme intransitif qui a déjà conduit le travail du poète.
J’ai donné ailleurs le détail des exercices pratiqués lors des répétitions de nos spectacles : repérage des inflexions conventionnelles, recherche d’accents par les variations rythmiques, mesure de la valeur expressive des intervalles de hauteur, renouvellement du rapport entre les intentions et les inflexions, recherche de la résonance (2).
Le texte est travaillé d’abord recto tono - l’énergie individuelle, la sensibilité de l’oreille, la faculté d’enraciner son écoute et son corps dans le sol déterminant la hauteur et l’intensité de l’émission vocale (dont l’acteur soutiendra le plus souvent son rôle). Le relief du discours tient entier à cet axe, à cette note fondamentale d’où les écarts, les éloignements, les rapprochements plus ou moins progressifs et sensibles de la voix seront perçus comme arsis et thésis, facteurs de tension ou de détente, et nuances dramatiques d’intention ou de sentiment du personnage interprété. Mais - notons-le d’emblée - la diction linéaire, le refus de l’écart ne sont pas moins sentis comme des écarts eux-mêmes, d’une radicalité propre à nous jeter dans des terres encore mal défrichées de la psychologie. Nous leur attribuons quelque raison cachée - ou qu’on ne sait nommer ou que l’on voudrait taire, ou dont on aimerait détourner l’aveu clair… Du côté du l’acteur, certaine retenue, certaine réticence, certaine peur de blesser qui écoute peuvent porter la parole sur une seule hauteur, dans un dépouillement qui semble alors pudique ; ou bien tout au contraire une franche, une puissante détermination, le soin seul de se bien faire entendre, rendre son dénuement provocant. Les ressources de cette ambiguïté interprétative sont précieuses à l’exigence d’un théâtre d’art, inquiet ici encore d’explorations nouvelles de nos moyens d’expression.
La recherche rythmique s’appuie sur cet axe vocal dépouillé, qui par ailleurs l’appelle et concentre l’attention de l’acteur sur la diversité de ses propres valeurs interprétatives. Il importe déjà d’éviter la scansion pléonastique, de fuir la transposition littérale des schémas métriques trop évidemment inscrits dans le vers. Ainsi par exemple :
communément scandé :
(coupe trois-trois-deux-quatre avec accents sur 3, 6, 8, et 12), pourra devenir un premier temps :
le décalage simple d’un rythme ïambique brève-longue étayant une recherche ultérieure plus subtile.
Le rythme est par ailleurs chose trop personnelle, trop riches de valeurs irrationnelles sont le débit de la parole humaine et son élévation au degré poétique, pour calquer les rapports de durée fixés par quelque notation que ce soit… Dans l’exemple cité, le rapport brève-longue n’est pas de 1 à 2 ; mais les appuis vocaux s’affirment plus nombreux, la prononciation plus consciente (moins de syllabes sont mangées), le vers plus allongé, et l’exaspération (ici de Titus) plus étrangement soutenue. L’ïambe est l’équivalent d’un battement de cœur –– aussi indispensable qu’imperceptible.
Les inflexions de voix sont enfin tolérées, travaillées, les unes peu contrôlables de quarts et tiers de tons, les autres demi-tons d’une grande force expressive. De plus grands intervalles (appuyés d’intentions, de sentiments divers qu’ils inspirent souvent) vont sculpter le discours - et surtout les contrastes, les ruptures, les silences et l’essentielle respiration, lui donner vie entière. Un acteur doué des sens poétique, capable de ce « basculement de la perception » que j’évoquais plus haut, et suffisamment fait à tous ces exercices, peut bien improviser des pans de tout son rôle : rien ne touche davantage que les inflexions (ou les gestes) qui semblent échapper à toute préparation comme à l’acteur lui-même… C’est une erreur commune, d’ailleurs, que de séparer trop nettement le calcul de la spontanéité : l’improvisation règne sur toute chose telle une nécessité - y compris sur les relectures critiques, les reprises et les corrections. L’œuvre la plus écrite, volontaire, rigoureuse, creusée des mois durant, n’en est que la conservation des plus heureux moments.
§§§
Qu’est-ce donc que parler, s’inquiétait le poète… Et qu’est-il donc possible à l’homme d’exprimer ? Quelle est la nature de l’expression même ? Que cache ce que nous mettons en mots ?
L’étonnement, l’amertume, l’impuissance déguisée de mépris, le balbutiement du bord des larmes, tout ce dont un quasi-monochrome de è clairs semés de labiales peut féconder les ressources intimes d’une sensibilité d’acteur (d’actrice en l’occurrence) servira, sous-tendra si l’on veut la diction de ce vers. L’interprète de Narcisse y voit, elle, un baiser ; mais elle ne s’en tient pas à la lecture mimique - et elle s’écarte, souvent, de l’acquis des répétitions dirigées… Je l’entends certain soir improviser tout ce passage dans un glacial refus du sentiment.
Du fragment suivant de mon propre Adonis, fragment perçu agressif par ses voyelles claires è, a froissées de fricatives et de r - et agressif encore par la tension dramatique particulière à cet endroit -, cette même interprète donne une leçon douce, sensuelle presque, fondée sur une étrange tendresse :
Le dessein de chercher, par les moyens de l’art poétique et théâtral, l’expression de ce qui puisse - par exemple - échapper aux catégories répertoriées de la psychologie, se trouve d’un contresens heureusement servi…
Les sentiments des hommes, mais aussi bien leurs actes, leurs histoires, ne sont rien de nouveau. La vie glisse la main dans notre marionnette (fort dure à enfiler d’abord, fort étroite, si l’on en croit les contorsions et cris du nouveau-né), et s’amuse d’elle-même en remuant les doigts dans nos membres, dans notre tête, en nous prêtant ses voix, en nous occupant. Elle fait nos personnages, nous oppose, nous accouple, nous distrait les uns des autres (de paroles, d’actions)… Elle nous fait ses pantins jusqu’à ce qu’elle se lasse comme l’enfant d’un jeu, et dépouille la guenille usée… On voit la trame.
Qu’est-il possible donc à l’homme d’exprimer ? Que cache ce que nous mettons en mots ? Ce que nous sentons être, sans doute, cette matière qui nous forme, et nous compose un temps avec assez de force pour nous inspirer l’erreur de nous croire durables, plus durables qu’elle-même, - comme devant succéder à la dissolution du spectre que nous serons, comme ayant précédé la formation de l’embryon que nous fûmes… Comme existant ailleurs, plus loin qu’entre ces brumes. Aux sources semble-t-il de l’expression humaine, ce sentiment premier ne peut avoir de nom. Les paroles lui sont vaines dans leurs affirmations, vaines dans leurs négations, et dans leurs questions mêmes. La poésie, la diction, l’orchestique, signes de révoltes d’un langage et d’un corps qui se tournent contre leur impuissance à sortir de leur norme, font le sujet vrai, le drame, l’agon dont se nourrit la représentation théâtrale. À l’extérieur des mots, à l’apparence des gestes, tout le vieux fardeau de sens, de dire conventionnel, d’histoires et de mythes portés depuis toujours… Au vers conscient de soi comme au corps exercé, l’effort, du moins l’essai d’en arracher l’écorce.
§§§
La parole d’abord. Des élans, des repos nécessaires et de leurs alternances, la seule substance intime fait vivre le discours. L’énergie profonde, la pression vitale passent des entrailles au diaphragme, puis au poumon puis dans la gorge qui les distille par la voix… Soutenue de la sorte, la diction la plus dépouillée - recta vox - n’est pas neutre : l’oscillogramme permet dans suivre les résonances par les resserrements et les contractions de l’onde vocale émise. On sait comment l’accent renforce l’attaque d’un son, étire son corps central en précipite l’arrêt. Par syllabes ou par mots, l’accentuation soutient le rythme qu’elle engendre de valeurs longues, discrètes mais peuplées et vibrantes. L’effet touche le système nerveux tout en empêchant l’analyse de ses causes. On parle de « présence », « d’aura » d’un comédien dont cette technique s’est faite nécessité intérieure… (Il n’y a que la vérité qui trompe.)
La parole est sans doute une étrange manière de communiquer ; mais la forme du corps humain n’est pas moins singulière, ni sa verticalité ni son équilibre bizarre. L’orchestique, transposition scénique des moyens de la poésie, requiert de l’acteur la plus grande conscience corporelle possible - sensation du centre de gravité, répartition du poids sur les jambes, angles formés par la position du corps et la direction du regard (j’abrège beaucoup) -, et la plus grande conscience de la manière dont il sera physiquement perçu depuis les différents points de vue (et d’écoute) de la salle. Jeu debout, jeu au sol, transitions, stations, mouvements individuels et d’ensemble sont réglés avec un soin comparable à celui qui régit l’écriture ou la diction. Il s’agit de faire en sorte, là aussi, que tous les déplacements et gestes prennent un sens à la fois distinct et distant de celui que la vie quotidienne leur impose ; il s’agit encore de donner, du rapport, du conflit de nos pensées et de nos actes, une image fondamentale, essentielle, modèle si possible - et par là même étrange.
Traduire ; prolonger ; creuser ; renforcer ; corriger, contredire (mais pour mieux soutenir), par les mots ce que l’on voit ; par les inflexions, les mots ; par les gestes et les regards, les inflexions ; par les silences et les stations, l’ensemble… Des entrées et des sorties de scène, des temps de présence (parlante ou muette) de ses différents acteurs, le poème ordonne la progression logique et comme chorégraphique des diverses combinaisons. Mais la mise en scène portée par l’orchestique assure et l’intérêt visuel et l’unité psychique de cette progression, dans une marge nécessaire de dissonances et d’asymétries ; de décalages, de manques, d’attentes qu’elle sait respectivement redresser, combler ou surprendre, - d’erreurs heureuses qu’elle sait fondre dans son harmonie particulière.
Pas de décor. Le noir contient tous les possibles. L’acteur se meut dans l’axe de lumière qui lui suffit. Pas de costume, que ceux qui près du corps épousent discrètement le moindre mouvement. La discrétion s’étend à leur couleur. Pas de musique surtout ! Le vers, la voix suffisent. Des gouttes de musique pure tout au plus - rarissimes, étrangères à la mémoire, de source invisible, mais aussi sensibles alors qu’un personnage réel - peuvent creuser brièvement le relief acoustique et par leur timbre, leur hauteur et leur intensité éveiller le désir du timbre de la voix humaine… Telle s’annonce l’épreuve, la lutte, l’agônia de ces forces premières dont la représentation tragique porte le témoignage, et tente à l’air qui nous entoure comme à la terre qui nous porte de rendre un hommage radical - violent parfois, et passionné (3)...
Je n’ai jamais senti, dans aucune forme d’art que je connaisse, un plus grand souci, une plus grande soif d’enracinement de l’expression de l’être au profond de lui-même, que dans ce théâtre que je rêve et m’acharne à construire depuis plus de vingt ans - en ne pouvant au mieux que l’approcher. L’écriture représente la première difficulté : la conscience de ce qu’est le vers, de ce qu’il peut être, et du peu d’exemples de réussites dans l’art poétique incite à la plus exigeante prudence. Le temps préside à ce travail. (Ce n’est pas le temps passé à les faire qui prouve la qualité des œuvres, mais la qualité des œuvres qui prouve ce qu’elles ont coûté de temps.)
Ce temps caché donne au poème toute sa puissance. Le vers s’avance, progresse, à chaque instant semé de phonèmes nouveaux et malgré tout semblables, de syllabes différemment les mêmes, et fécondé enfin de leurs résonances comme rétroactives. Les ondes sonores sont renvoyées épouser la forme de l’objet qui leur a donné naissance. L’oreille ne sait que décider d’entendre, du propos initial ou des mots de surface…
Une séquence versifiée à tel degré de profondeur peut produire, sous-jacent, souterrain, quelque rythme second infiniment lent, caché sous celui de la succession pleine des syllabes, et propre à créer une sourde mesure du gouffre - celui de la vanité de l’expression orale courante, celui des brumes d’avant notre naissance etc., tout ce que je sens que nous avons de plus vrai. Nos langues n’ont pas plus de corps que chacun d’entre nous : à supposer que le mot de réalité ait un sens, la parole en rend mieux compte par son bruit que par ses velléités sémantiques. Seul ce bruit composé la peut faire entrer en résonance avec elle-même d’abord, et par conséquence espérée avec son objet ou avec autrui. Et pourquoi pas ? avec les arbres, les rochers, les hommes les plus farouches…
§§§
C’est le propos de Orphée (4), effort vers la lumière, dont le commencement tourne rimes et assonances à l’obsession de ce rouge - rouge-orange, rouge intense, rouge sang -, celui même des plus basses radiations lumineuses que puisse du spectre d’émission saisir l’œil humain… En composant toutes ses résonances dans l’ambitus du timbre vocal, Orphée crée le chemin de sa descente. Il explore le langage dans ses sonorités encore en formation, dans leurs bruits, dans leurs dessous chromatiques complexes : in bleu-vert cendre, miroir ; an roux et paille ; ou ocre et pourpre… Rigueur formelle, recherche syntaxique, plein emploi des ressources phoniques de la langue gouvernent son progrès :
D’un verre épais, un vernis à l’ocre rouge appliqué sur des sels d’argent fait un miroir. Nos ancêtres déjà couchaient leurs morts dans un lit d’ocre, sur le côté du cœur.
Sur le plateau, dans l’espace de la scène, la densité de l’air est tout autre : de là ces voix, ces gestes, ces déplacements aux rythmes altérés de résistances, de réticences ; de là ce statisme vibrant, ces ruptures brutales… De là surtout ces dons, et de quel prix. C’est cette altération de la substance vivante qui rend plus réel, plus conscient et plus précieux pour chacun d’entre nous — acteur ou spectateur — le sentiment de son existence.
Lors d’une représentation idéale, nous ne nous émerveillons plus de ce que nous percevons d’extérieur à nous-même, mais de ce que nous sommes, et de ce que nous soyons… Pour mieux dire : de cette différence de notre indicatif à notre subjonctif, de cet intervalle vibrant et résonnant qu’implique la vie, rendue en son théâtre aussi vraie que virtuelle.
(1) Louis Latourre, Note sur la mise en scène de Narcisse de Paul Valéry, programme du spectacle, 1994 (création en Afrique de l’Ouest [Bamako, Abidjan, Niamey] et à Paris, Fondation Deutsch de la Meurthe). Cité par Jürgen Schmidt-Radefeldt, « Narcisse », Forschungen zu Paul Valéry [Kiel], Nr.6, pp. 188-90 (p.189).
Or le silence cède à de nouveaux accents. La nappe d’eau prend corps et devient Nymphe, Femme, et tout ce que l’amour peut offrir de concret. Et Narcisse un instant croit saisir son image… Mais cet amour offert n’est pas celui voulu. Un désir sans réponse, un malheur réciproque sont seuls à rapprocher Narcisse et l’Amoureuse. Nul ne saurait s’unir, et plus intimement qu’au plus proche des dieux qu’est chacun pour soi-même.
Ce nous-même à nous-même, insaisissable enfin, est le dernier reflet sur quoi le rideau tombe, d’un Narcisse réduit à l’écho de son chant (1).
§§§
On me pardonnera, je l’espère, d’engager mon lecteur à me suivre sur des chemins qu’il n’appartient qu’à la poésie de tracer. La diction de l’acteur, l’orchestique (art du geste) s’y soumettent au poieîn autant que l’écriture. La mise en scène entière n’est pas moins travaillée. Tentative d’approche, effort vers l’essence de l’expression humaine, la recherche d’un théâtre d’art véritable se situe au cœur même - je n’ose dire en amont - de toute la recherche dont l’expression demande la parole, et le corps.
§§§
Qu’est-ce donc que parler, s'interroge un poète... Quel est cet acte étrange ? Et d’où vient tant de foi dans cette expiration, dans cette restitution d’un peu de l’air qui nous entoure changé en verbe par l’appareil de la phonation, et revêtu de sens par l’habitude ? Tandis que nos yeux cherchent, tantôt en nous-mêmes, tantôt dans tel autre, à peser ce presque immatériel effet de paroles dans l’inquiétude de quelque affermissement secret…
Nous ne savons au mieux que notre incertitude. Jusqu’en leurs inflexions, jusque dans leur phrasé, nos langues n’ont de sens que par des conventions que la force d’habitude nous rend insensibles. Travaillés de leur bruit dès avant la naissance, soumis à leurs figures dès nos balbutiements, dressés à leur usage le plus commun par toute notre éducation, nous ne pouvons guère adultes nous défaire ni des notions, ni des questions, ni des schémas de raisonnement contenus par avance dans leurs mots imposés. Vocabulaire, syntaxe, conjugaisons, modes et temps nous offrent suffisamment de combinaisons possibles pour donner le change : nous confions notre pensée à ces mots, à ces phrases, dont nous identifions (et substituons) la production intellectuelle à la perception des vérités et des réalités qu’ils sont censés couvrir. Nous ne pensons jamais - et pour cause - quelles pensées notre langage nous empêche de former.
C’est précisément là, pesant notre ignorance, mesurant les limites de nos capacités d’expression (et celles de cette conscience dont nous doutons si peu d’être doués), que nous concevons mieux comment peuvent naître et grandir une poésie et un théâtre soucieux de s’affirmer contre le sentiment d’impuissance essentielle qui les engendre - une poésie d’abord, inquiète de se dresser suffisamment armée contre toutes les réponses réflexes dont la parole nous tient captifs. Il faut prendre au langage de quoi le renverser. Il faut créer le vers.
Il peut sembler étrange (et l’on s’étonne parfois) de voir un poète vivant demander à la forme versifiée les chemins d’une expression nouvelle. On invoque le grand poids des contraintes du nombre ou de la rime, de la rigueur formelle, de tout l’appareil désuet de l’ancienne poésie que le XXe siècle a voulu dépoussiérer. Mais si l’on fonde son observation sur une histoire littéraire plus large, on s’aperçoit que le premier soin des poètes de tout temps a été d’affranchir leur art des règles en vigueur - non pas en les fuyant, sans doute - mais en les dominant, en les recréant ; en les fécondant chacun pour son usage. Un vers de La Fontaine appartient à lui seul.
Le vers, pour un poète, n’est pas une forme préétablie dans laquelle la pensée n’aurait qu’à se couler sans effort. Le vers est ce qui affecte le plus profondément la langue. Laissant à l’extérieur des mots le rôle ordinaire d’intermédiaire, de truchement de la pensée, le vers demande de leur chair la matière d’une action, d’un effet d’ordre physique et sensible qui amplifie la résonance intellectuelle, et dont s’élargisse le spectre de la signification. Le nombre, la rime et le reste ne paraissent plus que les conséquences du travail profond qu’ils ont appelé : la composition d’accents, de timbres, de couleurs phoniques dont la recherche syntaxique et la rigueur formelle saisissent et fixent les rapprochements les plus expressifs. La leçon (je l’avoue) ne m’en paraît pas si indifférente qu’il faille la laisser perdre. Telle la musique, telle la peinture, la poésie compose des éléments étrangers à toute idée de traduction dans une langue particulière. Le vers est cette chambre de résonance où la pensée et l’expression cherchent l’accord extrême, le point idéal où entendre et comprendre ne seraient plus qu’un mot de même sens.
La moisson des exemples se confond avec la poésie même. De ses diphtongues ici, Racine fait une langue plus charnellement pesante :
Va, dis-je ; et sans vouloir te charger d’autres soins, | ||
(Bérénice) |
Des nasales, Corneille tente une approche au plus près du souffle détimbré (telle une expiration) :
Il est teint de mon sang. /Plonge le dans le mien, | ||
(Le Cid) |
Des mêmes nasales dominées de graves, Valéry descend vers la nuit :
L’amour la plus profonde | ||
(Cantate du Narcisse) |
Relisons ces fragments à voix haute. Essayons d’en peser physiquement les attaques et les tenues (par le jeu des consonnes et des voyelles), la richesse des rimes intérieures (Va, dis-je /Vois si je ), les effets de miroir (teinture du tien ), la distribution des sonorités par resserrements, renversements et monnayage, etc. L’appréhension poétique véritable ne souffre ni l’impatience du regard ni cette étrange lecture muette au rythme indépendant de toute respiration. Elle demande au contraire le temps, la durée, et la perception résonnante de ce qui n’est plus seulement écrit mais composé. Dans le cadre d’un théâtre d’art, elle demande ce lecteur et cet acteur singulier pour qui, plus encore que la pensée, la pesée du langage jusque dans ses phonèmes est source d’émotion.
Pour nombre d’entre nous ce réel basculement de la perception n’est pas toujours facile - ni même toujours possible. Sans doute l’habitude de la prose, l’abondance quantitative de la littérature qu’elle produit et le type de lecture qu’elle engendre n’en favorisent-ils guère l’opération. (Ajoutons qu’aussi vagues que répandues, les notions de « musique des mots » ou de « musique de l’idée » attachées à l’écriture du roman et du poème en prose ne peuvent qu’entretenir la confusion.) Mais la physiologie mentale apporte d’autres lumières sur la nature profonde de la compréhension - ou de l’incompréhension - poétique. En attribuant à des régions cérébrales distinctes, d’un côté l’intellection linéaire et la résorption signifiante du langage, et de l’autre son appréhension comme spatiale (incluant le rythme et la résonance), cette science fait dépendre de la perméabilité ou de l’étanchéité des frontières entre ces zones l’orientation du sens esthétique individuel… Aux « étanches » semblerait tout accès poétique interdit.
Une image concrète - empruntée à l’optique - donne de mon propos l’illustration la plus nette. La perception poétique reflète celle de ces créations de l’imagerie informatique appelées stéréogrammes, dont les motifs de surface cachent une figure virtuelle d’un puissant relief. Seuls ceux qui savent voir plus loin que l’apparence perçoivent cette figure surprenante, parce qu’elle surgit d’un point de convergence oculaire étranger à l’habitude du regard (point focal repoussé, reculé dans l’espace au-delà du dessin) - un point focal qui superpose et fond les motifs différemment perçus des deux yeux droit et gauche. Ainsi, face au poème, la saisie du vers dans tout son relief exige la participation sensible des deux hémisphères cérébraux ; et traversant la page, transcendant l’évidence, le point de convergence intellectuelle d’un langage élargi à tout l’être… Même à voix murmurée, même du bout des lèvres, il faut donner au vers tout ce qu’il veut de souffle pour prendre chair en nous.
De Malherbe, Corneille, Racine et quelques autres, la leçon nous révèle autant les chemins faits qu’elle peut en suggérer d’autres - qu’ils n’ont su faire. Ralentie, renforcée par une écoute profonde, la lecture poétique devient chorégraphie du mouvement des lèvres, de la langue, des vibrations du larynx - la seule mélodie de timbres (mélodie intérieure, modulations des couleurs phoniques en fonction des voyelles dominantes) jouant de la mémoire du degré d’ouverture de la bouche. Les tensions vers les voyelles extrêmes (i, u aiguës et o, on graves), les retours vers les moyennes (ain, ein), la durée des tenues et leur périodicité semblent vecteurs d’un sens dont l’étude appartient aux rapports de la psychologie et de l’acoustique… Les ondes du langage ont sans doute leurs ultra-violets et leurs infrarouges, dont les bornes sont précisément celles que l’effort poétique tente d’approcher voire de franchir : peut-être le plaisir sensoriel de la diction (que le vers semble toujours conçu pour susciter) s’explique-t-il par la sensation d’épouser pleinement certaines régions de leur spectre phonique, et par l’excitation d’en risquer des explorations nouvelles de la profondeur ou des limites sensibles.
§§§
Prose ou vers il est vrai - nous ne pouvons parler que nous ne soutenions le son de nos paroles de timbres, de hauteurs, d’intensités, de rythmes, dans une dépendance plus ou moins heureuse des sentiments qui gouvernent le choix de nos mots et l’effet que nous cherchons à produire en parlant. Mais s’agissant du vers - du vers irréductible, composition des plus expressives ou des plus rares dont soit capable le langage écrit - nous devons espérer du travail de l’acteur une composition d’équivalente qualité dans son rendu sonore, une séquence d’inflexions choisies qui transpose à l’oreille, dans l’espace de la scène, cette recherche d’un dire absolu et comme intransitif qui a déjà conduit le travail du poète.
J’ai donné ailleurs le détail des exercices pratiqués lors des répétitions de nos spectacles : repérage des inflexions conventionnelles, recherche d’accents par les variations rythmiques, mesure de la valeur expressive des intervalles de hauteur, renouvellement du rapport entre les intentions et les inflexions, recherche de la résonance (2).
Le texte est travaillé d’abord recto tono - l’énergie individuelle, la sensibilité de l’oreille, la faculté d’enraciner son écoute et son corps dans le sol déterminant la hauteur et l’intensité de l’émission vocale (dont l’acteur soutiendra le plus souvent son rôle). Le relief du discours tient entier à cet axe, à cette note fondamentale d’où les écarts, les éloignements, les rapprochements plus ou moins progressifs et sensibles de la voix seront perçus comme arsis et thésis, facteurs de tension ou de détente, et nuances dramatiques d’intention ou de sentiment du personnage interprété. Mais - notons-le d’emblée - la diction linéaire, le refus de l’écart ne sont pas moins sentis comme des écarts eux-mêmes, d’une radicalité propre à nous jeter dans des terres encore mal défrichées de la psychologie. Nous leur attribuons quelque raison cachée - ou qu’on ne sait nommer ou que l’on voudrait taire, ou dont on aimerait détourner l’aveu clair… Du côté du l’acteur, certaine retenue, certaine réticence, certaine peur de blesser qui écoute peuvent porter la parole sur une seule hauteur, dans un dépouillement qui semble alors pudique ; ou bien tout au contraire une franche, une puissante détermination, le soin seul de se bien faire entendre, rendre son dénuement provocant. Les ressources de cette ambiguïté interprétative sont précieuses à l’exigence d’un théâtre d’art, inquiet ici encore d’explorations nouvelles de nos moyens d’expression.
La recherche rythmique s’appuie sur cet axe vocal dépouillé, qui par ailleurs l’appelle et concentre l’attention de l’acteur sur la diversité de ses propres valeurs interprétatives. Il importe déjà d’éviter la scansion pléonastique, de fuir la transposition littérale des schémas métriques trop évidemment inscrits dans le vers. Ainsi par exemple :
L'univers a-t-il vu changer ses destinées | ||
| (Racine, Bérénice) |
communément scandé :
L’univers | a-t-il vu | changer | ses destinées |
(coupe trois-trois-deux-quatre avec accents sur 3, 6, 8, et 12), pourra devenir un premier temps :
L’uni | vers a | -t-il vu | changer | ses des | tinées |
le décalage simple d’un rythme ïambique brève-longue étayant une recherche ultérieure plus subtile.
Le rythme est par ailleurs chose trop personnelle, trop riches de valeurs irrationnelles sont le débit de la parole humaine et son élévation au degré poétique, pour calquer les rapports de durée fixés par quelque notation que ce soit… Dans l’exemple cité, le rapport brève-longue n’est pas de 1 à 2 ; mais les appuis vocaux s’affirment plus nombreux, la prononciation plus consciente (moins de syllabes sont mangées), le vers plus allongé, et l’exaspération (ici de Titus) plus étrangement soutenue. L’ïambe est l’équivalent d’un battement de cœur –– aussi indispensable qu’imperceptible.
Les inflexions de voix sont enfin tolérées, travaillées, les unes peu contrôlables de quarts et tiers de tons, les autres demi-tons d’une grande force expressive. De plus grands intervalles (appuyés d’intentions, de sentiments divers qu’ils inspirent souvent) vont sculpter le discours - et surtout les contrastes, les ruptures, les silences et l’essentielle respiration, lui donner vie entière. Un acteur doué des sens poétique, capable de ce « basculement de la perception » que j’évoquais plus haut, et suffisamment fait à tous ces exercices, peut bien improviser des pans de tout son rôle : rien ne touche davantage que les inflexions (ou les gestes) qui semblent échapper à toute préparation comme à l’acteur lui-même… C’est une erreur commune, d’ailleurs, que de séparer trop nettement le calcul de la spontanéité : l’improvisation règne sur toute chose telle une nécessité - y compris sur les relectures critiques, les reprises et les corrections. L’œuvre la plus écrite, volontaire, rigoureuse, creusée des mois durant, n’en est que la conservation des plus heureux moments.
§§§
Qu’est-ce donc que parler, s’inquiétait le poète… Et qu’est-il donc possible à l’homme d’exprimer ? Quelle est la nature de l’expression même ? Que cache ce que nous mettons en mots ?
Mais que ta bouche est belle en ce muet blasphème ! | ||
(Valéry, Fragments du Narcisse) |
L’étonnement, l’amertume, l’impuissance déguisée de mépris, le balbutiement du bord des larmes, tout ce dont un quasi-monochrome de è clairs semés de labiales peut féconder les ressources intimes d’une sensibilité d’acteur (d’actrice en l’occurrence) servira, sous-tendra si l’on veut la diction de ce vers. L’interprète de Narcisse y voit, elle, un baiser ; mais elle ne s’en tient pas à la lecture mimique - et elle s’écarte, souvent, de l’acquis des répétitions dirigées… Je l’entends certain soir improviser tout ce passage dans un glacial refus du sentiment.
Du fragment suivant de mon propre Adonis, fragment perçu agressif par ses voyelles claires è, a froissées de fricatives et de r - et agressif encore par la tension dramatique particulière à cet endroit -, cette même interprète donne une leçon douce, sensuelle presque, fondée sur une étrange tendresse :
Vois, Mère ! Vois en moi ta propre chair, Myrrha. |
Le dessein de chercher, par les moyens de l’art poétique et théâtral, l’expression de ce qui puisse - par exemple - échapper aux catégories répertoriées de la psychologie, se trouve d’un contresens heureusement servi…
Les sentiments des hommes, mais aussi bien leurs actes, leurs histoires, ne sont rien de nouveau. La vie glisse la main dans notre marionnette (fort dure à enfiler d’abord, fort étroite, si l’on en croit les contorsions et cris du nouveau-né), et s’amuse d’elle-même en remuant les doigts dans nos membres, dans notre tête, en nous prêtant ses voix, en nous occupant. Elle fait nos personnages, nous oppose, nous accouple, nous distrait les uns des autres (de paroles, d’actions)… Elle nous fait ses pantins jusqu’à ce qu’elle se lasse comme l’enfant d’un jeu, et dépouille la guenille usée… On voit la trame.
Qu’est-il possible donc à l’homme d’exprimer ? Que cache ce que nous mettons en mots ? Ce que nous sentons être, sans doute, cette matière qui nous forme, et nous compose un temps avec assez de force pour nous inspirer l’erreur de nous croire durables, plus durables qu’elle-même, - comme devant succéder à la dissolution du spectre que nous serons, comme ayant précédé la formation de l’embryon que nous fûmes… Comme existant ailleurs, plus loin qu’entre ces brumes. Aux sources semble-t-il de l’expression humaine, ce sentiment premier ne peut avoir de nom. Les paroles lui sont vaines dans leurs affirmations, vaines dans leurs négations, et dans leurs questions mêmes. La poésie, la diction, l’orchestique, signes de révoltes d’un langage et d’un corps qui se tournent contre leur impuissance à sortir de leur norme, font le sujet vrai, le drame, l’agon dont se nourrit la représentation théâtrale. À l’extérieur des mots, à l’apparence des gestes, tout le vieux fardeau de sens, de dire conventionnel, d’histoires et de mythes portés depuis toujours… Au vers conscient de soi comme au corps exercé, l’effort, du moins l’essai d’en arracher l’écorce.
§§§
La parole d’abord. Des élans, des repos nécessaires et de leurs alternances, la seule substance intime fait vivre le discours. L’énergie profonde, la pression vitale passent des entrailles au diaphragme, puis au poumon puis dans la gorge qui les distille par la voix… Soutenue de la sorte, la diction la plus dépouillée - recta vox - n’est pas neutre : l’oscillogramme permet dans suivre les résonances par les resserrements et les contractions de l’onde vocale émise. On sait comment l’accent renforce l’attaque d’un son, étire son corps central en précipite l’arrêt. Par syllabes ou par mots, l’accentuation soutient le rythme qu’elle engendre de valeurs longues, discrètes mais peuplées et vibrantes. L’effet touche le système nerveux tout en empêchant l’analyse de ses causes. On parle de « présence », « d’aura » d’un comédien dont cette technique s’est faite nécessité intérieure… (Il n’y a que la vérité qui trompe.)
La parole est sans doute une étrange manière de communiquer ; mais la forme du corps humain n’est pas moins singulière, ni sa verticalité ni son équilibre bizarre. L’orchestique, transposition scénique des moyens de la poésie, requiert de l’acteur la plus grande conscience corporelle possible - sensation du centre de gravité, répartition du poids sur les jambes, angles formés par la position du corps et la direction du regard (j’abrège beaucoup) -, et la plus grande conscience de la manière dont il sera physiquement perçu depuis les différents points de vue (et d’écoute) de la salle. Jeu debout, jeu au sol, transitions, stations, mouvements individuels et d’ensemble sont réglés avec un soin comparable à celui qui régit l’écriture ou la diction. Il s’agit de faire en sorte, là aussi, que tous les déplacements et gestes prennent un sens à la fois distinct et distant de celui que la vie quotidienne leur impose ; il s’agit encore de donner, du rapport, du conflit de nos pensées et de nos actes, une image fondamentale, essentielle, modèle si possible - et par là même étrange.
Traduire ; prolonger ; creuser ; renforcer ; corriger, contredire (mais pour mieux soutenir), par les mots ce que l’on voit ; par les inflexions, les mots ; par les gestes et les regards, les inflexions ; par les silences et les stations, l’ensemble… Des entrées et des sorties de scène, des temps de présence (parlante ou muette) de ses différents acteurs, le poème ordonne la progression logique et comme chorégraphique des diverses combinaisons. Mais la mise en scène portée par l’orchestique assure et l’intérêt visuel et l’unité psychique de cette progression, dans une marge nécessaire de dissonances et d’asymétries ; de décalages, de manques, d’attentes qu’elle sait respectivement redresser, combler ou surprendre, - d’erreurs heureuses qu’elle sait fondre dans son harmonie particulière.
Pas de décor. Le noir contient tous les possibles. L’acteur se meut dans l’axe de lumière qui lui suffit. Pas de costume, que ceux qui près du corps épousent discrètement le moindre mouvement. La discrétion s’étend à leur couleur. Pas de musique surtout ! Le vers, la voix suffisent. Des gouttes de musique pure tout au plus - rarissimes, étrangères à la mémoire, de source invisible, mais aussi sensibles alors qu’un personnage réel - peuvent creuser brièvement le relief acoustique et par leur timbre, leur hauteur et leur intensité éveiller le désir du timbre de la voix humaine… Telle s’annonce l’épreuve, la lutte, l’agônia de ces forces premières dont la représentation tragique porte le témoignage, et tente à l’air qui nous entoure comme à la terre qui nous porte de rendre un hommage radical - violent parfois, et passionné (3)...
Je n’ai jamais senti, dans aucune forme d’art que je connaisse, un plus grand souci, une plus grande soif d’enracinement de l’expression de l’être au profond de lui-même, que dans ce théâtre que je rêve et m’acharne à construire depuis plus de vingt ans - en ne pouvant au mieux que l’approcher. L’écriture représente la première difficulté : la conscience de ce qu’est le vers, de ce qu’il peut être, et du peu d’exemples de réussites dans l’art poétique incite à la plus exigeante prudence. Le temps préside à ce travail. (Ce n’est pas le temps passé à les faire qui prouve la qualité des œuvres, mais la qualité des œuvres qui prouve ce qu’elles ont coûté de temps.)
Ce temps caché donne au poème toute sa puissance. Le vers s’avance, progresse, à chaque instant semé de phonèmes nouveaux et malgré tout semblables, de syllabes différemment les mêmes, et fécondé enfin de leurs résonances comme rétroactives. Les ondes sonores sont renvoyées épouser la forme de l’objet qui leur a donné naissance. L’oreille ne sait que décider d’entendre, du propos initial ou des mots de surface…
Une séquence versifiée à tel degré de profondeur peut produire, sous-jacent, souterrain, quelque rythme second infiniment lent, caché sous celui de la succession pleine des syllabes, et propre à créer une sourde mesure du gouffre - celui de la vanité de l’expression orale courante, celui des brumes d’avant notre naissance etc., tout ce que je sens que nous avons de plus vrai. Nos langues n’ont pas plus de corps que chacun d’entre nous : à supposer que le mot de réalité ait un sens, la parole en rend mieux compte par son bruit que par ses velléités sémantiques. Seul ce bruit composé la peut faire entrer en résonance avec elle-même d’abord, et par conséquence espérée avec son objet ou avec autrui. Et pourquoi pas ? avec les arbres, les rochers, les hommes les plus farouches…
§§§
C’est le propos de Orphée (4), effort vers la lumière, dont le commencement tourne rimes et assonances à l’obsession de ce rouge - rouge-orange, rouge intense, rouge sang -, celui même des plus basses radiations lumineuses que puisse du spectre d’émission saisir l’œil humain… En composant toutes ses résonances dans l’ambitus du timbre vocal, Orphée crée le chemin de sa descente. Il explore le langage dans ses sonorités encore en formation, dans leurs bruits, dans leurs dessous chromatiques complexes : in bleu-vert cendre, miroir ; an roux et paille ; ou ocre et pourpre… Rigueur formelle, recherche syntaxique, plein emploi des ressources phoniques de la langue gouvernent son progrès :
chant (…)
chants tous, en touchant… Tous en creusant la fange… |
OMBRE 1
Branches, bois déchirés voient quels chagrins tu sens… |
ORPHÉE
Quels chemins froids faisant… |
OMBRE 1
Laisse au couchant creuser tous ces degrés de cendre |
D’un verre épais, un vernis à l’ocre rouge appliqué sur des sels d’argent fait un miroir. Nos ancêtres déjà couchaient leurs morts dans un lit d’ocre, sur le côté du cœur.
ORPHÉE
De pâles, froids échos font se glacer ma langue. |
OMBRE 1
Tu ne poursuis, Orphée, en l’ombre où tu descends |
Sur le plateau, dans l’espace de la scène, la densité de l’air est tout autre : de là ces voix, ces gestes, ces déplacements aux rythmes altérés de résistances, de réticences ; de là ce statisme vibrant, ces ruptures brutales… De là surtout ces dons, et de quel prix. C’est cette altération de la substance vivante qui rend plus réel, plus conscient et plus précieux pour chacun d’entre nous — acteur ou spectateur — le sentiment de son existence.
Lors d’une représentation idéale, nous ne nous émerveillons plus de ce que nous percevons d’extérieur à nous-même, mais de ce que nous sommes, et de ce que nous soyons… Pour mieux dire : de cette différence de notre indicatif à notre subjonctif, de cet intervalle vibrant et résonnant qu’implique la vie, rendue en son théâtre aussi vraie que virtuelle.